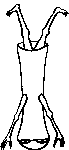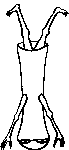
l y avait les mots, serviteurs empressés et corvéables, toujours aux aguets, trop souvent aux ordres. Petites mains prêtes à jouer des coudes et des ongles pour proposer leurs services, laquais en livrée, qui venaient tirer leur révérence au sein de la mêlée et trouvaient toujours à en tirer quelques avantages. Il y avait les mots qui me perdaient à trop vouloir les tenir, qui me dissolvaient dans un à peu près sordide et dépeuplé.
Il y eut un immense dégoût qui était aussi une peur.
Il y eut le silence. Non pas ce recul, cette distance intime et maîtrisée d’avec les faits et leur image, cet entre-deux qui n’était peut-être après tout qu’un autre regard, qu’une autre vitesse appliquée aux êtres et aux choses.
Il y eut le silence comme une chausse-trape, une glissade, un gouffre. Un véritable coup d’épée. Un accroc dans la toile tendue des signes, une entaille à vif dans le tissu sergé des faits et gestes. Un silence vaste et non mesuré (et quelle aune me restait-il pour la mesure ?). Un vertige.
Bientôt les mots ne firent plus ni son, ni sens. Les phrases s’avalèrent d’elles-mêmes. Avec les mots, se perdaient les formes, les couleurs, les textures, les contours, les saveurs, les bruits. Chaque mot perdu entraînait avec lui bien plus d’un monde. La conscience douloureuse un instant m’en effleura, puis je perdis le mot, et avec lui la conscience, et par-delà elle la douleur. L’idée de la perte elle aussi se perdit. Les mots devenus distants n’avaient plus cette matérialité rassurante que l’usage avait pu leur prêter. Ils n’opposaient qu’un très faible contact, s’étiraient soudain à perte de vue, ou se recroquevillaient à l’infime, face à moi qui espérais encore les saisir. Tout ce dont je les avais cru chargés, émotions, notions, souvenirs, se dévidait à l’envi. Seules vibraient quelques notes désaccordées qui ne participaient même plus d’une harmonie. Il ne me resta plus qu’un temps indivis, sans partition, un état sans variation, une impression sans contour, une boule monochrome au balancier suspendu, au cœur serré comme un nodule.
Pourtant ça passait. Cette station ultime était aussi celle d’un affût. Les proies venaient au plus près, sans nul doute étais-je même littéralement traversé, transpercé d’un mouvement intime que je ne pouvais cependant ni nommer, ni retenir. Les eaux filtrées étaient de même nature que le crible, ce qui venait du dehors s’incorporait directement sans que l’opération dévoilât son signe. Ça ne parlait plus et pourtant ça passait. Je devins peu à peu le dépositaire hébété d’une pensée poreuse, d’un quant-à-soi liquide. Les images s’entrechoquaient et œuvraient sans qu’il y eût de quoi les fixer, sans que je puisse en laisser de trace autre qu’hallucinée. J’assistais sur le quai à mon propre départ, sans savoir pour autant ce qui de moi partait, ce qui était appelé à revenir.
Et puisqu’il fallait partir, je partis.
Au bout il y eut la mer. La mer en son entier, inattendue, brusque, soudaine. Le vacarme dressé tout d’un bloc d’une voix impossible. Le phrasé tendu comme une corde à se rompre. Cri unique et mille fois modulé sur une gamme monodique. Par-dessus il y eut, couronne acérée, le bal entêté des oiseaux qui lâchaient leurs cris en autant d’invectives. C’était un mur qui se dressait à l’horizon de toute perspective, une butée, le point où tout devait arriver et s’abîmer. Cette frontière n’était qu’un cri, tout ce qui s’y confrontait devait en passer par la hargne, la frénésie. Il me fallait surmonter la vague, désosser le rocher jusqu’à son échine, arracher l’écume à l’épiderme, écumer moi-même, être moi-même le centre et le tourbillon, la cognée et la lame. Me fondre hurlant au sein du vacarme pour entendre ma propre voix, pour que l’écho qui en revienne m’assenât en retour l’hypothèse d’un pourtant-là, d’une existence. Pour que la voix qui semblait naître d’un lointain horizon vienne sourdre à mon oreille comme ma plus proche incarnation. Il me fallait être balayé d’un coup par les paumes de la houle, rendu à rien, pour pouvoir en resurgir. Les à-coups des vagues, les sautes brassées du vent, tout ce concert déchaîné à mon encontre et qui m’atteignait de plein fouet venait forer ses questions. Je ne tenais plus, et pourtant je retrouvais le fil. J’étais là le corps essoufflé, le souffle transi et j’entendais gronder en moi, vague à vague, un incroyable flot, une mer terrible. Face à l’océan se pressait une mer intérieure. Sur la falaise, nez à nez avec l’abîme je devenais estuaire, j’éclatais en delta. De ma bouche sortait un océan qui venait se mêler à celui qui me narguait. J’assistais étonné, presque dépossédé, à leur heurt.
Les mots déboulaient. Je ne les subissais plus. Ils n’étaient plus ces cadres mal cotés, ces enveloppes ajourées, ces trames lâches. Ils pointaient, luisants, tranchants, métalliques, brisés en de pleins pans de granit. Ils se taillaient rageurs une voie jusqu’à la gorge, ils tranchaient une saignée à travers la langue, emportant avec eux un trophée de salive. C’était d’une violence inimaginable. Une marée qui arrachait sa route au sable, martelant sa phrase aux rochers, broyant les mots dans une coulée vive. Je les prenais longuement en bouche pour sentir leur haleine, retrouver leur lustre, faire briller un éclat qui n’était plus celui de l’artifice, mais bien la lave interne d’une veine à vif. Je les regardais étonné. Chacun brûlait d’une flamme que je n’aurais su dire. Ces mots, qui me revenaient en foule armée et terrible, étaient transfigurés. Bien plus, c’était toute la part de réel qu’ils portaient en eux qui s’en trouvait ainsi métamorphosée. Eux que j’avais cru finis, étriqués, fossiles, s’étaient gonflés au vent terrible de la réalité, à ses lames tangibles, à sa brutalité éprouvée. Ils m’en revenaient grandis, démesurés, infinis. À leur tour ils brisaient les limites d’un entendement clos. À les entendre, ils me portaient très loin au-delà de moi-même. Ce n’était plus moi mais bien eux qui me tenaient. Ils démultipliaient le monde à foison, ouvrant à chaque détour une cargaison d’images que je pensais ne devoir jamais s’épuiser. Un mot en entraînait une cascade, une phrase amorçait un tourbillon. Cela ne dura sans doute que quelques instants, mais ce que je touchais (et que je touchais concrètement, dans toute l’âpreté de sa matérialité) me donnait assez pour tenir un peu, pour tenir encore.
À mon retour de Bretagne, j’entrai en contact avec les membres du groupe surréaliste de Paris.
Ma relation au langage et au monde, qui est son inséparable corollaire, est ainsi faite de ces sautes subites et violentes. Dilué, accablé par sa marche ordinaire, perdu dans un ensemble qui me heurte et me disperse, pris dans une toile qui me voile et dans laquelle je m’égare jusqu’à en perdre mon centre de gravité, il me faut la violence d’un crime pour passer outre. Ma parole est donc le récit tendu des ces meurtres successifs, et je sais bien qu’en dépit de quelques improbables instants de réconciliation - qui tiennent à la fragile magie du désir, à l’émerveillement renouvelé de la surprise -, ce que ma voix parvient à dire n’est que la marque d’une continuelle lutte à outrance, violence qui ne peut s’apprivoiser qu’au risque de se tarir.