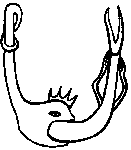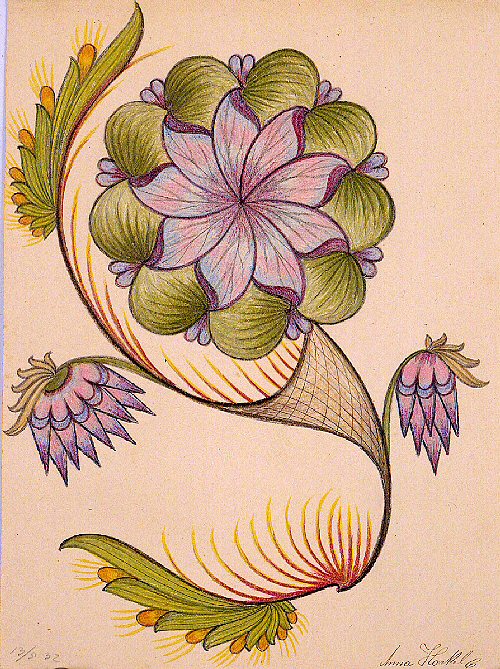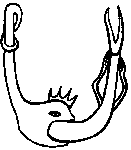
ne kyrielle de visions en rapport avec les multiples sens stratifiés de n’importe quel terme isolé du lexique anime tout mot évoqué en me l’ouvrant comme un oculaire de kaléidoscope ou de longue-vue panoramique. L’image visuelle (les objets, le paysage que je rencontre…) à son tour se manifeste comme une enveloppe de mots - je me la représente en l’instant comme une trousse d’écolier gonflée de petits bouts de papier avec un mot à multistrates de sens sur chacun, telle une galette des rois feuilletée à la pâte d’amande. La précision acérée d’une description au vocabulaire prétendument univoque m’aveugle de sa lame de poignard. Il me souvient que j’ai pourtant joué à cela, à la justesse, dès la naissance de mon désir d’écrire - je n’avais pas dix ans. Je me rappelle la jouissance enfantine de donner à voir (à quel public virtuel ?) un monde inventé par fantaisie, en sélectionnant chaque mot afin qu’il traduise sur le papier, avec le plus de réalisme possible (les enfants craignent souvent que ça ne ressemble pas), ces images créées sans nécessité intérieure. J’estime depuis que, plus l’écrit se veut coller précisément à une pensée par le biais d’un discours explicite, plus l’écrivant se contente de ne parler qu’à soi-même. Ce qui nous porte à trouver de l’intérêt à la netteté de cette vision qu’autrui nous offre toute faite, si toutefois nous parvenons à la recevoir, est sans doute de l’ordre d’un voyeurisme oisif - et cet onaniste fascinant n’est-il pas une métaphore de l’homme de pouvoir ?
D’une image verbale ou d’une image plastique, j’ai la nette conscience de ne percevoir qu’en parallèle ce qu’on me donne à voir - le biais sagace est peut-être ce trait de regard qui traverse à l’oblique les diverses lentilles de verre d’un télescope pour mieux contempler ce qui est situé au-delà. Le propos qu’on m’adresse, je le « com-prends » analogiquement, aussi technique en soit sa tournure. Mon discours sur le monde, élaboré depuis mes sens et mon expérience, récrit le discours de l’autre, comme le discours de l’autre récrit le mien ; la distance qui sépare ces plans homologues, d’où s’ensuit plus ou moins de clairvoyance, se rétrécit autant qu’augmente la proximité des interlocuteurs. Le mystère de cette croisée des parallèles - car il est indéniable que ces discours se croisent pourtant : c’est ainsi que se structure de l’échange autour des désirs -, je n’ai pas encore trouvé les mots pour le dire, pourtant je suis essentiellement plongée dans cette quête, en silence. Un réel magique s’y esquisse, où toute parole est sort et où l’agencement de tous ces sortilèges ordonne le monde - la mise en forme symbolique a toujours des pouvoirs surnaturels. Dans l’espace-temps particulier de cette paradoxale croisée des parallèles, corne d’abondance du merveilleux, évoluent des trésors tels que les hasards objectifs, l’écriture automatique, l’art médiumnique, etc. Parallèlement donc, soit dans un perpétuel voisinage dont l’écart reste logiquement irréductible, la vision verbalisée par autrui devient d’ordinaire un tableau que je recompose, utilisant seulement certains des indices descriptifs fournis, l’atmosphère de la scène dépendant principalement de l’émotion que me donnent tel et tel mots, pour des raisons souvent indépendantes de la vision offerte - une sonorité, un jeu de mots, une sollicitation affective... Il m’importe peu de ne pas parvenir à me représenter exactement le spectacle dépeint, mais je sais gré au narrateur de pouvoir ainsi tisser ma toile.
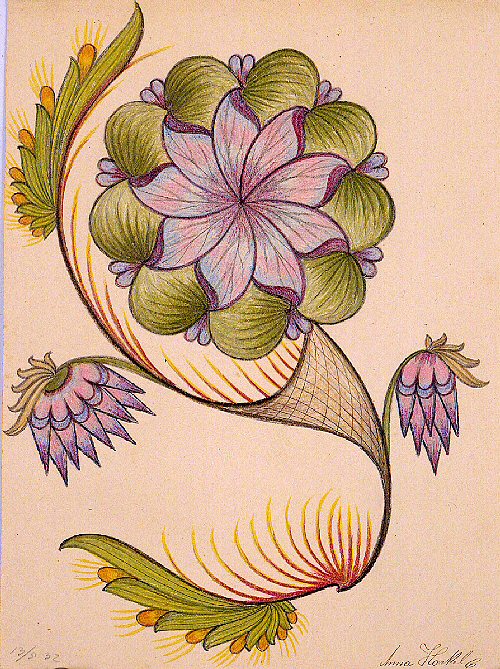
- Anna Haskel
Les sons, odeurs, saveurs, le toucher sont des sensations physiologiques difficiles généralement à représenter, si directes de l’objet au corps. Lorsqu’il s’agit de les recevoir par le détour d’une image, que celle-ci soit plastique ou langagière, je me trouve déconcertée tant je suis persuadée que je ne pourrai ni entendre le timbre qu’on dépeint, ni respirer les arômes qu’on évoque, ni savourer les parfums qu’on montre, ni éprouver les contacts qu’on décrit : j’en ressentirai toujours d’autres, inévitablement et quand on parlerait des mêmes. Communiquer ce qui atteint sensoriellement se heurte d’abord à une difficulté de penser intimement cette perception en termes réfléchis - comme si le miroir ne renvoyait aucune image, aucune lumière et que tout se passait dans l’obscurité, sous la peau, écorchant vif le corps et l’âme sans protection, sans paroles non plus, avec d’autant plus d’intensité que cela demeure indicible. Une éventuelle pauvreté de langage n’expliquerait pas cette entrave à décrire la source de mes émotions…Une image symbolique, vague réminiscence, vient ici à la rescousse : dans la nuit noire, je ne puis voir la chouette réellement présente et, dès qu’il fait jour, je ne sais que témoigner de son absence - voire jurer de son inexistence. Comment dire mieux cette impossibilité-là de communication ? Dans mes textes, je crois n’avoir utilisé qu’allégories ou métaphores pour exprimer les sensations. Il en est de même lors d’échanges oraux : je ne me souviens pas avoir osé quelque prosaïsme que ce soit, persuadée que tout réalisme tenté serait une assommante chute de pavé.
Cette chouette ne se dissimule pas seulement sur le terrain des « sensorialités » : diverses expériences me paraissent aussi indécelables. Il n’y a pas moyen de montrer, de trouver de témoins et pourtant, assurément, la chouette EST là. Plus exactement, plusieurs sont là, souvent, se taisant, et nul autre que soi n’en a la preuve . On met un peu de lumière : un mot, un nom, un verbe ; pfft ! ils ont disparu, il n’y a plus que l’éclairage et rien à voir, le langage a gommé la pensée. Ce n’est pas simplement la submersion de l’expression par l’affect, mais une sorte d’effacement intérieur des sensations au fur et à mesure qu’elles sont traduites en mots. Je crois que cette dévastation par le langage ne tient pas seulement en ce que celui-ci dit trop peu, mais en ce qu’il dit autre chose ; car s’il enlève une partie des sensations, d’une certaine manière il en ajoute ; bref, il transforme. L’intrusion du temps, nécessairement, métamorphose l’instant : la pensée a quelque chose d’instantané par rapport au langage. Foudroyante, elle nécessite un intermédiaire, un arrangement pour devenir approchable. Cela terrasserait-il l’être humain d’avoir le penser dicible ? Est-ce une aspiration métaphysique ?
La tentative de figer par le langage un rêve dont on sort donne une idée assez juste de cette sorte d’infirmité que j’éprouve à traduire en mots la pensée. Ce n’est pas pour autant qu’intimiste rime avec inabordable : le langage commun utilisé à des fins personnelles peut permettre d’être clair à l’aide de tropes, malgré une subjectivité certaine. Quand il n’est même plus possible d’utiliser son propre glossaire pour mettre en mots l’affect, la sensation, le sentiment, la méditation, alors la conscience d’inadaptation devient torturante - sauf à l’aimer pour ce qu’elle est : un champ poétique à ensemencer ; et à l’accueillir pour ce qu’elle inaugure : du merveilleux, voire un mystère que notre dénuement apprivoise - comme si le principe image devenait la clef inutile d’une porte, dont on aurait changé la serrure et qui serait porteuse du rêve d’inaccessible mirifique. Le glossaire de tout le monde, aussi riche serait-il, ne me donnerait pas les moyens de combler ce fossé « entre le mot et la chose », cet intervalle qui échappe au sujet entre ce qu’il connaît intimement (la perception de la chose) et ce qui est public (le lexique). On aura beau faire, comment ne pas se sentir culbuter dans la faille, qui rompt l’être entre le fait et sa mise en mots : entre la sensation de plaisir et le mot plaisir, entre le sentiment d’échec et le mot échec, le toucher rêche du granite et le mot rêche, l’affect de peur et l’expression j’ai peur, la représentation mentale de la révolte et le verbe se révolter… ? Ce ne sont qu’exemples, parmi tant d’autres dans l’infini du penser, de cette étrangeté absolue séparant ce qu’il y a en moi et ce que l’extérieur me propose comme palette - de plus, ce ne sont pas mes couleurs - pour le peindre. Comme ils semblent bizarres, ces mots sans corps ! Lointains de ce qui est vécu ! Ailleurs… Vivant leur vie propre sous la coupelle de terribles lettres qui tout à la fois leur donnent forme mais les tiennent prisonniers dans leurs chaînons (en matrices qu’elles sont). Monde de la Lune où je me fraie un chemin, de l’enfermement au libertarisme. Ainsi, mon attitude pour tenter d’approcher ma pensée par le langage consiste habituellement à l’apprivoiser : cela demande un long affût, une adaptation de comportement pour qu’il n’y ait aucune brusquerie effrayante, l’acceptation qu’elle se dérobe, du lâcher-prise à l’encontre de la logique ; il faut beaucoup de temps pour chasser les intermédiaires et retrouver un peu de l’immédiateté de l’esprit. À vouloir aller trop vite, on se retrouve sous influence sans avoir le temps de détecter celle-ci.
Que la pensée soit opérante en deçà du langage, j’en ai l’intuition. Comme on respire, la pensée rumine tout ; ou plutôt il pense partout, comme il neige, comme il fait chaud, froid, comme il est l’heure… Toutefois je n’adhère pas à l’idée que les inconscientes résolutions de problèmes, « dans toute leur évidence, sans effort apparent » soient principalement des « résolutions non verbales ». (Par exemple, la somatisation d’attitudes psychiques est passée au crible des mots, hors tout raisonnable, via la phonétique parfois, c’est-à-dire… la musique ! un coup peut résonner dans le cou ; ou encore : des gestes réflexes s’effectuent d’emblée en apparence, alors que le complexe jeu entre les neurones et les muscles qui l’a permis peut être analysé.) Remarquons, au passage, que le langage n’est pas seulement cet épouvantail structuré comme le pouvoir face à une pensée sous contrainte, puisqu’il joue des tours, se mettant souvent en marge de la rationalité. On ne pourra jamais schématiser les mots en du sens objectivement - arbitrairement ? totalitairement ? - codifié, ils sont graphisme, sonorité… tout autant traducteurs que nourriciers de la pensée. Ils participent certainement, hors de notre conscience, aux actions coordonnatrices, raccourcissantes ou court-circuitantes de la pensée apparemment immédiate, bien que n’étant pas les seuls agents opérants. Rien ne me permet de croire que le « rapprochement de réalités éloignées qui opère la justesse du raisonnement » soit véritablement d’une autre espèce qu’un discours, lequel je n’ai peut-être pas en conscience, ou pas encore. Rien non plus ne m’empêche de le croire. Selon les moments, j’incline pour l’une ou l’autre interprétation, mais aucune certitude ne l’atteste jamais . Néanmoins il serait intéressant de cerner la nature (ou les différentes natures) de cette part de la pensée qui n’est pas du langage, quelque étendue qu’elle occupât. Qu’est-ce qui permet à ces personnes atteintes de lésions « dans la zone du cortex antérieur et médian » de comprendre encore ce qu’elles ne peuvent plus nommer ? Autrement dit, qu’est-ce qu’une fonction cognitive qui permette de la conscience et qui soit indépendante du langage au sens strict ? (Ce langage ici utilisé pour véhiculer ses propres incapacités de transmission : paradoxe sans issue !)
Analyser méthodiquement le processus de l’entendement, c’est se heurter à la contradiction de devoir utiliser un outil - la logique - aux possibilités beaucoup trop restreintes pour le matériau sur lequel on opère - la pensée au sens le plus large ; un peu comme si l’on se contentait des coordonnées du plan pour se situer dans l’espace à trois dimensions . Certes, les connaissances objectives donnent des indices - et les différents ensembles structurés du cerveau en sont - mais que penser d’une « conception première » immédiate, qui se passerait de langage ? Cela a-t-il un sens, alors que tout concept est issu d’une interaction entre trois ensembles neuraux dont on ne peut envisager d’éliminer la part dévolue à la combinaison des mots ? Pourquoi seule la communication obligerait-elle à user du langage ? Tout ne l’atteste pas, trop d’événements liés entre deux ou plusieurs personnes ne nécessitent aucun discours, ni intérieur, ni énoncé. Je ne parle pas de ce qu’on appelle communément transmission de pensée, car cette pensée-là est langagière souvent ; mais de ce qui se passe, par exemple, à distance entre deux personnes qui ont même oublié avoir été d’une quelconque façon liées jadis mais dont les existences continuent de se faire écho de manière significative et sans qu’elles le sachent. Il n’y a là correspondance d’aucun message verbal ou bien il faudrait considérer que le message a été émis très longtemps auparavant et qu’il continue de faire effet. De quel type de communication s’agit-il alors ? Je doute que ce ne soit que de mots, parce que la mise en mots reste plutôt ce qui permet de garder ses distances. D’ailleurs, un malentendu fondamental règne au sein de la tentative de caractériser le langage : on lui prête à la fois le pouvoir de faire comprendre (comprendre, c’est prendre avec soi) et de clarifier la pensée en l’objectivant (c’est-à-dire en l’éloignant pour la voir). Le langage a tant d’ambivalences qu’il paraît de plus en plus douteux de lui imputer la propagation de l’idéologie car c’est par lui d’abord que celle-ci se saborde. L’idéologie se retrouve le jouet du langage qu’elle a la prétention de manipuler. Comme on ne peut résoudre l’énigme de la primauté entre la poule et l’œuf, on ne sait pas davantage, du langage et de l’idéologie, qui est la dupe. Lui a une autonomie précédant ceux qui l’utilisent : le maîtriser relève d’une volonté de possession et de pouvoir sur le monde qu’il me semble nécessaire de dérouter.

- La Fille du capitaine Nemo
- Emmanuel Fenet
La spécificité du langage qui transmet de la poésie amène à se questionner sur le fait poétique : ne serait-il que réaction ? La fonction d’efficacité informative du langage primerait alors, contraignante, puis l’individu aurait eu, avec le temps et la volonté, pour exister parmi la communauté ou par nécessité de solitude salvatrice du sujet, de parler contre pour exprimer un penser autre… N’est-ce pas une vision induite par le discours rationnel sur le langage, celui-ci n’aurait-il pas plutôt germé spontanément dans la bouche de l’homme confronté au sacré - invocateur plus que transmetteur, efficace métaphysiquement ? Là où se manifeste la différence évidente entre l’animal et l’humain, et où l’enjeu, mobilisateur d’une grande puissance de désir, peut provoquer le miracle. S’il ne s’était agi que d’une économie de la conservation du corps, de sa reproduction, le genre animal n’eût rien eu à envier à l’espèce humaine. Mais ce qui montait, tandis qu’homo s’érigeait, c’était une sève désirante et spirituelle nécessitant le langage pour s’adresser au vent ; au soleil ; à l’espace ; aux pierres ; aux bisons ; à la nuit ; à ses semblables, reconnus comme tels - et mortels - et désirables - puisque parlant aussi… Nul besoin primordial alors de l’expression verbale transparente d’un concept précis. J’aime à penser que le langage poétique fut premier : l’on sait que la littérature naquit des cultes païens, via le théâtre ; quant à la philosophie, elle ne s’écarta de la poésie qu’avec le temps - il n’est que de relire Héraclite ; je ne peux m’empêcher de penser que l’humain fut parce que, avant toute chose, il s’embrasa, puis… embrassa. Le cri poétique à l’ascendant de l’humanité parlante en appelle au zénith de l’esprit, telle est ma vision non chimérique. Il n’est pas indispensable, pour avoir de la voix, de « parler contre » ; on peut « hurler à », et le désir retentit sous le ciel telles les implorations ardentes du chien à la Lune. Le fait poétique ne saurait se suffire d’un non à l’ordre - bien que l’oppression universellement rationalisante ait muselé l’être humain flamboyant et que celui-ci, quand il l’a pu, ait alors réagi - mais prétend retrouver la voie/x d’un acquiescement à la jouissance d’être en état de voyance. Que ce dernier soit communiqué l’indiffère assez : l’acte poétique est toujours susceptible de « se passer de tout public » ; l’invocation de l’homme, que je suppose aux origines du langage, n’avait pas besoin d’être diffusée.
L’infâme idée communément répandue de la poésie comme « art du langage » implique deux conjectures : premièrement, que le langage commun, encore une fois, soit prétendu antérieur au langage poétique ; deuxièmement, qu’il s’agisse d’une « pratique » incompatible avec la magie, c’est-à-dire de technicité. Même si, au pire - est-il seulement envisageable d’éclairer l’obscur à la lumière trop vive des Lumières sans en effacer les caractères fragiles comme ce fut le cas pour les dessins de Lascaux découverts ? - on devient, un jour, capable d’expliquer logiquement l’enchaînement qui relie le sentiment poétique à son expression (pour l’auteur) ou l’expression au sentiment poétique (pour le récepteur), cela ne permettra pas de comprendre comment cela s’est par enchantement mis en place depuis toujours. Quant à l’hypothèse d’en utiliser le procédé, elle me semble du même acabit que celle du savant qui espère donner vie à un organisme en assemblant la totalité de ses parties, aussi saines soient-elles. Misérables Frankenstein que ces poètes de la formule ! Bien que j’utilise les techniques subversives des règles communes qui ouvrent sur une révélation poétique, je considère que la poésie n’y naît point mais que, déjà née ailleurs et dissimulée pour raison de clandestinité nécessaire provisoirement à sa survie, elle glisse dans la chausse-trape de l’apparente innocuité du jeu. Mais la vie propre du poème - ou de toute autre œuvre poétique - n’est pas plus entre les mains de son inventeur que celle de l’individu ne se trouve prise dans les rets d’un dieu omnipotent : elle vole de ses propres ailes, page au vent d’un ouvrage d’alchimie effeuillé, promesse miraculeuse chuchotée par la brise dans la frondaison d’un mutus liber. Elle est opérative : ainsi j’adhère profondément à cette idée que la poésie donne à voir « mais aussi à entendre, à sentir, à toucher, à goûter ». Pour moi, le poème est une réalisation du sentiment poétique ; il n’est pas la seule forme d’expression qui permette cela ; lorsque j’œuvre à des assemblages dans l’espace, je procède de la même manière avec les objets choisis qu’avec les mots (associations, détournements, jouissance de regarder ou d’entendre, analogies initiatiques, clins d’œil, révélations involontaires). Tout ce qui est susceptible de manifester l’être humain comme vivant participe de la poésie.
Comment expliquer celle-ci, comment tenter d’en décrire le mouvement ? Tant de volumes ont déjà été écrits pour amorcer une réponse à cette question extravagante comme la quadrature du cercle . Le sentiment de poésie confère une qualité d’intensité particulière à certains instants d’existence, par coïncidence, c’est-à-dire sans rapport de cause à effet entre cette expérience et ce sentiment, et ce n’est pas l’instant qui procure le poétique (car nulle expérience n’en exclut l’occasion) ni le sentiment qui se superpose à un quelconque vécu pour le relire/redire en poésie, c’est la foudre qui surgit de la rencontre en un point du ciel et de la terre : que des mots soient cet éclat et jaillit le poème. Cela nécessite un double passage - dans les deux sens en même temps chaque fois - d’une part entre ce qui est vécu et ce qui est ressenti, d’autre part entre le ressenti et la réalisation poétique. Lors de ces deux passages, le sujet est remué autant que sollicité. Par exemple, la vue de l’extraordinaire noyer à ma fenêtre me remue en même temps que son existence sollicite ma réaction poétique. (Sur cette dernière peuvent s’ancrer la majesté de l’arbre, le souvenir d’un poème de Char où il est question de l’arrachage d’un noyer, la proximité homonymique évoquant la noyade, ma joie d’y guetter chaque printemps le retour du pivert qui tambourine l’annonce des beaux jours, le goût des noix fraîchement cueillies au pied du tronc quand autrefois je travaillais dans les champs, la valeur symbolique manifeste du fruit, l’« inconscient » du lieu - puisque l’étymologie couramment acceptée de Sannois est Cent Noix - , la langue des oiseaux qui me dit que « n’oie y est » ou encore que « Roy né » et que « n’oyez ! », etc. . Je pourrais continuer ainsi longtemps à énumérer tout ce qui requiert ma participation active.) En outre, entre ce fait et les mots que j’utiliserai pour l’écrire, je suis de nouveau soumise au langage dont les propositions m’émeuvent, mais je suis aussi celle qui révèle les mots à leur étoile dans cette aventure. Un autre exemple pourrait être pris où je partirais d’un poème lu pour aboutir - mais comme ces termes me gênent ! car authentiquement, tout a lieu simultanément - à ce réel qu’il me donne à vivre intensément. Ce double seuil me suggère qu’il s’agisse d’un complexe rite d’alliance pour honorer l’accouplement amoureux entre le sujet et l’objet de son discours (ou entre l’objet et le sujet de son discours) qui, en poésie, ne font plus qu’un.

- Katerina Kubikova
Je célèbre cette Alliance en usant des mots - comme lors d’un sacrifice. Je les laisse entrer pour leur son, leur écriture, leur graphisme (il n’est pas indifférent qu’ils portent majuscule, ce qui donne une tête de dragon à la phrase dont le signe de ponctuation devient la queue), pour l’idée qui m’en vient - qui se mêle à d’autres par les vertus de la polysémie, du mélange des registres verbaux, des degrés de compréhension, des archaïsmes ou néologismes réfractés, des anagrammes - tout en préservant la présence qui a surgi avec l’embryon du poème et qui, telle une déesse antique, se métamorphose selon l’amoureux courtisé. Elle demeure essentielle, cette présence, un peu fantôme, un peu ange gardien, onde vouivre ou souffle de dragon, voix de silence et oracle apollinien. Par moments, ce que le langage a de déchirant, dont j’ai parlé plus haut , me limite ; mais se produit tout aussi souvent une exaltante fécondité d’expression grâce aux outils auto-subversifs en prise directe sur sa matérialité : leur prise, fascinante au-delà de toute espérance, restitue l’esprit aux signes. La pratique des mots procure, comme l’amour, un mélange de meurtrissure et de jouissance ; je viens boire à leur source un philtre enchanteur. Il n’y a guère plus d’un an, j’ai mis un petit carnet gris à spirales dans mon sac pour y noter des listes de mots dont la sonorité entraînait un même type d’impressions en moi. Trop négligente, je n’y ai pas écrit grand-chose. Il y a pourtant une liste qui associe des dizaines de mots que je qualifie de « graves », où l’on trouve par exemple, la cornue, l’ogre, les créneaux, le crâne, âcre, la couronne et le groin ; une série de mots « qui scandent » avec coupe, queue, cœur et autres quand ; d’autres qui sont « doux », comme usage, dénude, écume, songe ; des mots « violents » tels trancher, étranger, transept, trinquer ; quelques-uns « de jonction » : joliesse, délier, vieille, union, viens ; d’autres « à sucer comme des bonbons » : émeraude, aubépine, anthémis, lobélie, doucereux, hémérocalle, précieux - ce sont toujours des liens sémantiques naissant de sonorités, mais auxquels j’adjoins mes propres déductions : les songes dénudent en douceur les usages ; le transept est la lame tranchante de l’église-épée ; l’ogre est un porc avec son groin, et tout ce qui porte couronne avec lui ; la vieillesse relie à l’autre ; Le temps est ce quand qui casse inscrit dans le cœur ; les épines de l’aubépine ont la caresse précieuse d’une journée qui éclôt, etc. Lorsqu’en revanche je joue sur les anagrammes ou toutes sortes de « mots dans les mots », c’est plus souvent sur l’aspect visuel, sur l’écriture que j’agis - quoiqu’on ne puisse ignorer l’aspect sonore lié aux lettres-phonèmes - ce qui est advenu précédemment avec mon noyer-n’oie y est.
Ce ravissement que je vis avec le langage a son revers de médaille : en tant qu’être ravi, j’échappe à tout autre ; or, n’étant pas en permanence dans cet « enlèvement », j’ai maintes fois l’occasion de souffrir de cette sensation d’inadéquation profonde et de solitude enracinée. Il a été question plus haut de la difficulté à trouver le mot pour dire la chose avec le plus d’exactitude possible afin de la transmettre, mais combien plus douloureux encore est le sentiment d’avoir choisi l’expression la mieux appropriée et qu’elle ne puisse faire partager l’impression personnelle car ce terme traduit précisément une autre notion chez l’interlocuteur renvoyé à ses propres miroirs. Chacun peut alors déclamer à l’intérieur de sa bulle de vapeur, comme une Pythie, l’oracle qui lui semble limpide ; les deux cris se font écho sans se répondre ni trouver de commune interprétation, et la souffrance se mesure à l’aune de cette impossibilité à glisser le même signifié sous un signifiant commun. Cette sorte d’incompréhension perturbe les relations humaines de façon perverse, dans ce qu’elles ont de plus intime, car l’écho parodie l’échange. Lorsque cela advient en poésie, la souffrance reste silencieuse, mais d’être muettes les douleurs n’en sont pas moins corrosives. Écrire ou lire et que cela reste lettre morte ne signifie pas que le message dort au fond d’un tiroir (cela ne gêne pas la poésie) mais que la représentation « ne passe pas ». Combien d’entre nous ont-ils refermé prématurément un ouvrage sous prétexte que « les raisins étaient trop verts » ? Combien sont-ils rentrés déconfits après s’être donnés à lire ? Sensations à hauteur de chagrin d’amour… et que la poésie, à l’égale du sentiment amoureux, sublime en s’y drapant, magnifique, mais que je soupçonne issues d’un manque de « solarité ». Le soleil entraînerait de l’évaporation autour de la Pythie, diffuserait de la clarté dans la communication, de la chaleur dans l’échange, détruirait les méfiances fongiques.
Nous n’en aurons, bien sûr, jamais fini avec la rivalité nécessaire entre nos deux luminaires, l’astre Roy et la Dame de nuit.