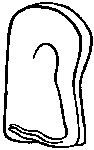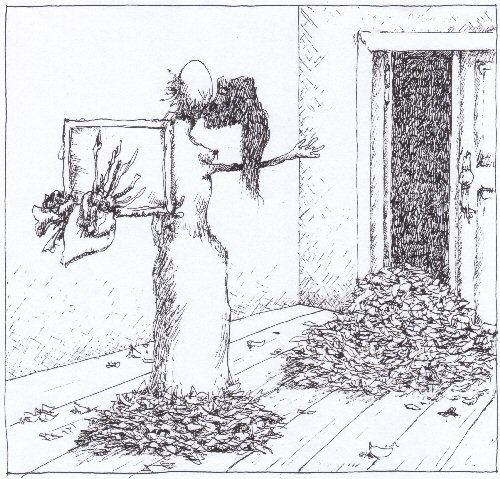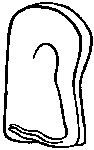
ans la démocratisation marchande des conditions de la perception, le surréalisme pictural commence à jouer le rôle consensuel assigné à l’impressionnisme au cours du siècle qui vient de s’achever. Preuve en sont les récentes expositions rétrospectives sur le surréalisme qui se sont déroulées dans les trois grandes capitales de la consommation artistique occidentale, New York, Londres et Paris. Avec leurs produits dérivés et leur couverture médiatique avariée (voir l’abject hors-série de Télérama paru à cette occasion), elles ont sélectionné un public actuel et potentiel qui, dûment désensibilisé, s’apprête à consommer sur plusieurs décennies du Max Ernst ou du Magritte, avec le même enthousiasme apathique que ses aînés ont consommé du Renoir ou du Monet. Cela ne veut pas dire qu’il faille fuir avec un aristocratique dédain ces kermesses de l’image où tout est fait pour que le regard ne puisse s’enivrer : même dans un si désolant contexte, les œuvres conservent leur puissance irradiante pour autant qu’on soit préalablement disposé à la capter, et donc suffisamment prémuni contre le principe même de telles manifestations. Il est à noter cependant que la seule de ces expositions qui présentât un parcours un tant soit peu organique et cohérent du surréalisme fut celle qui se tint à New York l’été 1999 : dans le décor somptueux du musée Guggenheim dessiné par Frank Lloyd Wright (la coquille est déjà d’une autre qualité que le pitoyable Centre Pompidou !), étaient exposées les œuvres rassemblées par deux collectionneurs, Filipacchi et Ertegun, qui témoignaient réellement d’un regard non limité par d’absurdes considérations d’histoire de l’art et, hormis le principe du choix subjectif, n’imposant aucune lecture idéologique implicite. L’exposition londonienne Desire unbound, qui occupait l’hiver dernier un étage de la très postmoderne annexe de la Tate Gallery (une centrale électrique reconvertie, à l’allure de sarcophage rappelant opportunément que les musées sont avant tout des cimetières), péchait déjà par un usage restrictif du concept de désir, ramené au seul désir amoureux, et par de risibles méprises : par exemple, notre ami Jean Benoît se voyant annoncé, tel un grand mort, au prétérit, ou la présence incongrue d’une Louise Bourgeois, qui, et pas uniquement comme son nom l’indique, n’a jamais rien eu à faire avec le surréalisme. Mais le comble dans la catastrophe devait venir - qui en eût douté ? - de l’exposition de ce printemps à Beaubourg. À l’évidence, c’est au cœur même de la ville où le surréalisme est né, a lutté, poursuit toujours son travail de sape et d’où il a tendu les réseaux capillaires qui ont irrigué ici ou ailleurs d’autres révoltes se réclamant de lui, qu’il fallait à tout prix établir un dispositif permettant de le conjurer : d’abord en en restreignant la portée historique, en le déclarant mort avec la Seconde Guerre mondiale, ce que n’avaient tout de même pas osé faire les organisateurs de l’exposition de Londres ; ensuite en créant une hiérarchie de pions de collège entre auteurs majeurs et mineurs (Ernst, Magritte et Dali sont outrageusement privilégiés) ; enfin, en donnant une vision du surréalisme adaptée aux préjugés déjà insérés dans la tête du visiteur : un mouvement misogyne (les œuvres des femmes ont été systématiquement sous-représentées dans l’exposition), soumis à l’autorité d’un pape irascible, mais qui a tout de même produit de bien belles fantasmagories.
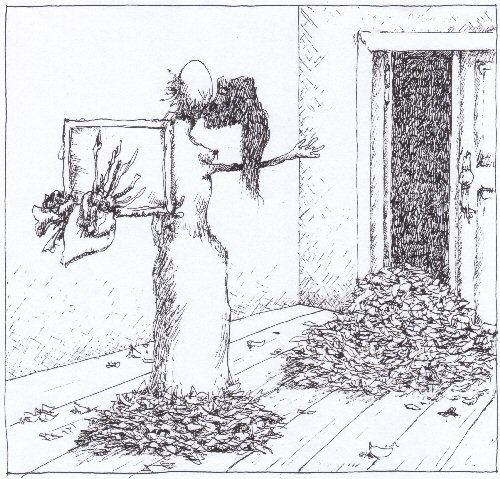
- Premysl Martinec